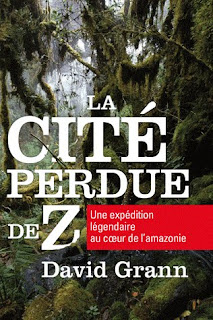« Personne ne laisse échapper une larme ou un reproche
à la déclaration de la maîtrise de Dieu,
qui, avec une ironie magnifique
m'a donné à la fois les livres et la nuit. »
On connaît ces beaux vers de Borges extraits du Poème des dons. On y entend bien sûr l’écrivain argentin évoquer sa cécité et sa passion des livres, un double destin contradictoire pourtant accueilli et accepté.
Cette nuit-là évoque aussi d’autres ténèbres, plus vastes encore, et c’est sans doute ce qui fait résonner ce poème au-delà de son seul ancrage biographique. On peut y entendre qu’aucun livre, pas plus que tous les livres réunis, ne viendra à bout de la nuit. Dans la Bibliothèque de Babel, la lumière est « incessante » mais « insuffisante », et la quête qu’impose cet univers labyrinthique est à son image, infinie, et donc par avance vouée à l’échec. Si dans la bibliothèque borgésienne tout ce qui peut être conçu est déjà un livre, le hiatus entre ce qui a de tout temps déjà été écrit et ce qui reste à lire est nécessairement irréductible. Et, dans ces lieux jamais éteints mais jamais pleinement éclairés, ce sont les hommes eux-mêmes («ces bibliothécaires imparfaits», selon la formule de Borges) qui peu à peu s’abîment les yeux et courent le risque de perdre la vue. Il y aurait finalement un lien consanguin entre lecture et cécité. On n’échappe pas à la nuit. A travers le narrateur de Babel, comme dans d’autres écrits, Borges procède à une mise en scène et une interprétation allégoriques de sa propre situation de lecteur aveugle. La nuit borgésienne circonscrit non seulement ce qui échappe à la vérité du livre, ce qui se dérobe à l’emprise du langage, mais elle pointe aussi les hexagones inexplorés du huis clos babélien. Lire, c’est lire avec tous les livres que l’on n’a pas encore lus et avec ceux qu’on ne lira jamais.
L’expérience de la lecture, tout aussi lénifiante soit-elle et quel que soit l’engagement sans retour qu’elle puisse susciter, est aussi nécessairement l’expérience d’une limite, d’une finitude. Il y a quelque chose qui se joue, dans l’acte même de lire, avec les livres que l’on n’a pas lus. Ils balisent un espace de possibles, une série d’échos qui n’existent pas encore. Ils appellent des choix, des renoncements, des mises en veille.
Les théories de la lecture littéraire ont souvent mis en évidence, notamment depuis Lector in fabula, et par la suite dans la lignée des travaux de Vincent Jouve, la façon dont le sujet construit lui-même le sens du texte, développe une activité interprétative, voire créatrice, à partir notamment de ses expériences antérieures de lecteur. Le plaisir de la lecture, tout comme la construction du sens, se joue également dans cette «compétence intertextuelle du lecteur » dont parle Umberto Eco, cet état d’éveil qui lui permet de laisser entrer en résonance le texte qu’il est en train de lire avec d’autres livres lus.
Mais il me semble que cette construction du sens et ce plaisir le renvoient aussi, au-delà de sa lecture « en acte », vers ce que l’on pourrait appeler la « zone d’ombre » de sa bibliothèque (il va de soi que je ne parle pas ici des livres que l’on décide, par goût, opinion, etc., de ne pas lire). Entrer dans un livre, c’est s’exposer à en désirer d’autres et l’effet de dominos, comme on le sait, peut durer longtemps, effet lui-même démultiplié et délinéarisé par la variété des lectures et par toutes les autres formes possibles d’incitation à lire (de l’échange entre amis à la consultation de blogs, en passant par la presse, la critique, etc.). Ainsi, paradoxalement, plus on lit, moins on lit — et la formule n’est pas réversible ! Ma bibliothèque idéale est toujours le négatif de cette autre bibliothèque, faite de rencontres suspendues ou mises en réserve, de livres que m’auraient donné envie de lire ceux que je n’ai pas pris le temps d’ouvrir, de mes futurs choix de lecture. Cette zone d’ombre est mouvante dans le temps, variable d’un lecteur à l’autre, et exponentielle : plus on l’éclaire, plus elle gagne du terrain.
Les rentrées littéraires sont souvent des occasions privilégiées d’en prendre la mesure. C’est un peu ce que fait Philippe Annocque dans une note récemment postée sur son blog, où il signale quelques lectures récentes, quelques promesses de bonheur au futur proche, mais évoque aussi sur un ton doux-amer tous ces livres qu’il ne pourra pas lire. Le lecteur est souvent contraint d’utiliser un tamis quand il aurait préféré une pelle !
Mais l’actualité littéraire n’est pas la seule rivière où de beaux poissons nous échappent. Chaque lecteur possède aussi dans sa zone d’ombre quelques grands livres, quelques monuments. Pour ceux-là, l’affaire est encore plus délicate. Il faut attendre le bon et le vrai moment, accepter de mettre entre parenthèses d’autres parutions plus fraîches qui nous font saliver, pour honorer enfin les grands rendez-vous manqués.
L’expérience est pourtant souvent salutaire. Car il y a dans certaines œuvres une sorte de force matricielle qui est elle-même génératrice de littérature. Elle convoque sur son territoire les écrivains à venir et donne au lecteur l’impression étonnante de lire bien des livres en un seul. Certains de ces textes entrent presque naturellement dans la sphère d’une sorte d’archi-littérature qui dialogue avec le mythe. Ils ouvrent des territoires si vastes, touchent à des interrogations si profondes, qu’ils en deviennent centrifuges, attirant dans leur champ de gravitation des pans entiers de la littérature future. Il est difficile d’évaluer le nombre d’œuvres dont la littérature aurait été amputée si nous n’avions pas eu Hamlet ou Macbeth ; le Quichotte de Cervantès enfante régulièrement des avatars, ou renaît de ses cendres, comme récemment encore, sous la plume de Kathy Acker ; Au cœur des ténèbres de Conrad a comme marqué par avance, de manière indélébile, un nombre considérable de productions littéraires… L'énumération pourrait se poursuivre.
Peut-être ces œuvres assurent-elles d’ailleurs une sorte de fonction seconde auprès du lecteur, le consolant partiellement de tous les livres qui lui échapperont dans sa courte vie d’« Homo legens ».
***
Je me permets donc, en cette période tout à la fois réjouissante et frustrante de rentrée littéraire, de revenir sur une œuvre majeure, connue depuis plusieurs années pour beaucoup, découverte récemment en ce qui me concerne.
Méridien de sang, de Cormac McCarthy, figurait jusqu’à cet été en bonne place dans l’un des nombreux rayons de ma zone d’ombre. Je dois à Anne-Françoise Kavauvea, lectrice généreuse, de m’avoir décidé à l’en sortir au plus vite.
De McCarthy j’avais souvent lu qu’il était l’un, si ce n’est le plus grand des écrivains américains contemporains et que Méridien de sang était probablement son plus grand livre. Il faut ceci dit parfois se méfier des enthousiasmes éditoriaux et quelques autres auteurs avaient déjà été gratifiés de ces superlatifs sans que je parvienne personnellement à m'en persuader en les lisant (je pense notamment à James Ellroy). Cette fois-ci, pourtant, la déflagration a eu lieu.
On trouvera, dans différents blogs, plusieurs chroniques enthousiastes de ce roman auquel on accorde depuis une dizaine d’années au moins le statut de classique de la littérature contemporaine. Je renvoie au bel article d’Anne-Françoise Kavauvea, dans De seuil en seuil. A noter également deux autres présentations intéressantes sur le blog Note d’un souterrain et sur l’ancien site de François Monti. Enfin, on pourra se reporter à deux analyses passionnantes de Juan Asensio (1 et 2) dans Dissection du cadavre de la littérature. Il s’intéresse notamment (mais pas seulement) aux résurgences de la figure de Kurtz (Au cœur des ténèbres) dans le personnage du juge Holden.
Méridien de sang se déroule dans le sud-ouest des Etats-Unis, sur les anciens territoires de la cession mexicaine autour des années 1850. Un gamin pauvre du Tennessee (jamais nommé) abandonne un foyer familial délétère et part trimarder sur les routes de son pays pour survivre. D’abord engagé au Texas dans une armée irrégulière qui doit rallier le Mexique, il s’associe bientôt, après le massacre de cette première équipée par une tribu comanche, à un groupe de sombres soldats et mercenaires chargés de sillonner un immense territoire à la seule fin, contre rétribution, de massacrer le plus grand nombre d’Indiens et d’en rapporter le scalp. La bande est conduite par un chef, Glanton, et un juge violent, mystérieux et charismatique, Holden.
Le roman alterne entre des scènes de combat et de massacre d’une rare violence et des déambulations sans fin dans ces régions désertiques et caniculaires. Le « gamin » passe rapidement au second plan alors que se détachent la figure de Glanton mais surtout celle du juge. Au fil des pages, le contexte historique et la motivation des tueurs d’Indiens perdent de leur visibilité pour laisser place à une longue errance sauvage et meurtrière qui se déploie dans un espace que plus rien ne semble pouvoir contenir ni délimiter. On voit se dessiner un univers chaotique presque hors du temps, où la violence, ici seule expression du droit, est à la fois assénée et subie par tous, Mexicains, Indiens, Américains. Le juge Holden s’apparente quant à lui progressivement à un prophète invincible et satanique, apologue surhumain d’une guerre perpétuelle qui dirait l’essence même de l’Homme. La dimension allégorique du personnage finit par s’affirmer de manière radicale aussi bien à travers ses gestes, ses paroles, que par les attributs magiques dont il paraît investi de façon de plus en plus flagrante. Il apparaît, disparaît, semble à l’abri des balles et des flèches, se tient nu en selle escorté d’un gnome à moitié fou, qu’il promène en laisse ou retient dans une cage.
Bien après la sortie du désert et le duel qui l’aura opposé au gamin, le juge fait une ultime apparition. La mystérieuse disparition finale du gamin marque le triomphe du juge, figure à la fois méphistophélique (il semble vouloir gagner l’âme du garçon) et proche d’un Zarathoustra dévoyé — ce que souligne notamment l’image obsédante de la danse à la fin du roman :
« Il danse dans la lumière et dans l’ombre et c’est un grand favori. Il ne dort jamais, le juge. Il danse, danse. Il dit qu’il ne mourra jamais. »
Mais c’est le style de McCarthy, avant toute chose, qui nous saisit. Dès les premiers paragraphes on sait que l’on sera porté jusqu’à la quatre centième page sans discontinuer.
Son écriture a une capacité d’extension étonnante qui lui permet de porter les mêmes coups avec des phrases brèves, nominales, qui font avancer rapidement le récit (c’est le cas par exemple au début du roman) que dans des propositions déliées à l’infini qui nous emportent sans un point sur une page entière.
Il parvient également, sans jamais renoncer au détail, sans jamais lâcher la bride à ce qu’il entreprend de nous donner à voir, à forcer la description réaliste pour glisser vers quelque chose de démesuré. Tout à la fois lyrique, épique et d’une extrême précision, la langue de McCarthy est à chaque instant puissante et maîtrisée.
La nature, qui occupe une place centrale dans Méridien, fait elle aussi l’objet d’un traitement fascinant. Elle est à la fois décrite avec beaucoup de minutie, McCarthy s’attardant sur les grands comme les petits espaces, donnant souvent son nom à chaque pierre, chaque arbre, chaque plante, n’hésitant pas à recourir au lexique de la géologie ou de la botanique, puis elle finit par redevenir, par cette précision même, une entité irréelle, quasiment abstraite, et d’une beauté létale.
On ne peut qu’adhérer au constat de Juan Asensio lorsqu’il déclare :
« Pas une ligne, dans ce livre noir, qui ne paraisse vivre de sa propre nécessité, absolue, pas une ligne (alors que je ne lis, bien sûr, qu'une traduction donc, a priori, un texte moins dense que l'original) de ce roman qui ne me semble gorgée de quelque suc puissamment corrosif. »
Pour illustrer ces propos, voici un passage, un peu long, mais qui me semble une illustration forte de cet univers sombre, violent, tenu par un style à la fois précis et empreint d'un certain lyrisme qui semble réconcilier, comme dans certaines pages de Salammbô de Flaubert, réalisme et baroque.
La scène intervient à la fin du chapitre 4. Le premier groupe de soldats sans foi ni loi auquel s’est associé le gamin est, au cours d’un baroud de courte durée, attaqué par surprise et décimé par une troupe de Comanches.
« Parmi les blessés certains semblaient hébétés et incapables de comprendre et d’autres étaient pâles sous les masques de poussière et d’autres s’étaient souillés ou s’étaient écroulés sur les lances des sauvages. Ceux-ci conduisant maintenant une frise endiablée de chevaux lancés tête en avant avec leurs yeux révulsés et leurs dents limées et de cavaliers nus avec des gerbes de flèches serrées entre les mâchoires et leurs boucliers qui étincelaient dans la poussière et revenant dans un piaulement de flûtes d’os sur l’autre flanc des rangs déchirés en se laissant glisser le long de leurs montures le talon suspendu à la longe de garrot et leurs petits arcs tendus par-dessous l’encolure allongée des poneys jusqu’au moment où la compagnie fut encerclée et ses rangs coupés en deux puis se redressant comme des mannequins de foire, certains avec des figures de cauchemar peintes sur la poitrine, piétinant les Saxons démontés et les transperçant et les assommant et sautant de leurs montures avec des couteaux et trottant curieusement de-ci de-là sur leurs jambes torses comme des créatures contraintes à d’étranges modes de locomotion et arrachant aux morts leurs vêtements et les saisissant par les cheveux et passant leurs lames autour des crânes des vivants comme des morts et levant bien haut les sanglantes perruques et tailladant et tranchant dans les corps dénudés, déchirant des membres, des têtes, vidant les bizarres torses blancs et brandissant de pleines poignées de viscères, d’organes génitaux, quelques-uns parmi les sauvages tellement imprégnés de matières sanglantes qu’ils semblaient s’y être roulés comme des chiens et d’autres qui se jetaient sur les mourants et les sodomisaient en poussant de grands cris à l’adresse de leurs compagnons. Alors les chevaux des morts surgirent au galop de la fumée et de la poussière et se mirent à tournoyer dans un martèlement de cuirs et de crinières sauvages avec des yeux blanchis par la peur comme des yeux d’aveugles et quelques-uns étaient hérissés de flèches et quelques-uns transpercés de coups de lance et ils trébuchaient et vomissaient du sang tandis qu’ils tournaient à travers le champ de carnage pour disparaître dans un grand bruit de harnais. »
Une grande surprise donc, qui se renouvelle à chaque instant, dans des scènes aussi furieuses que celle-ci, ou au contraire au cours de longues pages (faussement) paisibles où les paysages écrasants ont fait disparaître toute figure humaine.
Parfois les zones d’ombre ont du bon car je jouis d’un privilège que bien des lecteurs qui furent plus avisés que moi m’envieront : il me reste tous les autres romans de McCarthy à lire.
Cormac McCarthy, Méridien de sang. Point Seuil. 2001. Traduit de l'américain par François Hirsch.
Images : 1) Anselm Kiefer, Athanor, détail (Louvre, photo personnelle) / 3) Cormac McCarthy