David Grann est journaliste au New Yorker depuis 2003. Ancien rédacteur en chef de The New Republic et de The Hill après avoir collaboré à différents journaux de son pays, il est bien connu du public américain. Les Editions Allia (1) ont eu la bonne idée, en 2009, de traduire et publier deux textes de lui précédemment parus sous forme de longs articles dans le journal où il officie. Le Caméléon et Un crime parfait, ainsi devenus des livres, sont deux textes courts à cheval entre polar, chronique judiciaire, thriller psychologique et témoignage. Ils relèvent, à leur façon, et malgré leur brièveté, de la grande tradition américaine du journalisme d’investigation. Les éditions Allia n’hésitent pas à parler de journalisme littéraire et il n’est pas rare, aux Etats-Unis, que l’on compare David Grann au Truman Capote de De sang froid. Un troisième texte de Grann, la Cité perdue de Z, traduit cette fois d’un essai ambitieux publié en 2009 aux Etats-Unis, est également paru chez Robert Laffont en mars dernier. L’enquête journalistique y côtoie de manière très maîtrisée l’essai historique, la biographie et le récit d’aventure, autour de la figure emblématique de l’explorateur anglais Percy Harrison Fawcett.
Le Caméléon, paru le premier en français, retrace l’histoire troublante de Frédéric Bourdin, affabulateur et «transformiste» de génie qui usurpa ou endossa l’identité d’un nombre incalculable d’enfants entre 1990 et 2005. Polyglotte, doué d’un sens de l’observation et de l’imitation exceptionnel, Bourdin réussit sans quasiment jamais être démasqué à se faire admettre en tant qu’enfant maltraité et esseulé (par fuite ou abandon) dans divers établissements scolaires et familles d’accueil. Il reproduisit ce scénario dans plus d’une dizaine de pays. Aucun motif d’escroquerie n’a été révélé dans ces surprenantes prises d’identité, le seul motif de Bourdin semblant avoir été de compenser une enfance douloureuse en « devenant » ces différents autres enfants.
Un crime parfait revient sur une affaire sans doute moins connue, celle du meurtre, en Pologne près de Wroclaw, de Dariusz Janiszewski. Ce crime, d’abord non élucidé, fut excavé par un détective de police chevronné, Jacek Wroblewski. Celui-ci, à partir de la liste des appels reçus sur le portable de la victime, retrouve la trace d’un suspect un peu particulier, Krystian Bala, écrivain polonais auteur d’un roman sulfureux au titre lourd de sens, Amok.
Ce texte (2), pétri de références aux philosophes français de la postmodernité ainsi qu’à Nietzsche et Wittgenstein brouille ouvertement la frontière entre mensonge et vérité, auteur et narrateur. Ce dernier, prénommé Chris, se présente à plus d’un titre comme l’avatar de Krystian Bala. Certains épisodes du récit recoupent le parcours biographique de Bala et Amok essaime des indices qui tendraient à désigner son auteur comme l’assassin de Dariusz Janiszewski. Wroblewski découvre que plusieurs scènes du roman de Bala présentent en effet des similitudes troublantes avec celle de l’affaire Janiszewski et le poursuit sur cette base. La justice polonaise devra faire face à des questions peu courantes alors que Bala, qu’accable un faisceau de coïncidences étonnantes, se défendra en se présentant comme un nouveau Salman Rushdie menacé dans sa liberté d’invention. D’abord condamné à vingt-cinq ans de prison, Krystian Bala parviendra à faire annuler cette décision en appel. L’affaire serait encore en suspens… (Deux chroniques intéressantes de ce texte, ICI en français et ICI en anglais)
Ces deux textes, toutes différences gardées pour ce qui est des cas qu’ils retracent, posent de manière radicale la question du mensonge. Bourdin, menteur hors pair, permet d’une part de sonder cet insatiable désir de croire qui nous habite - et qui permet aux mensonges les plus aveuglants d’exister (et l'on pense notamment à l’Adversaire d’Emmanuel Carrère et aux dix-huit ans de mensonge de Jean-Claude Romand) ; d’autre part, il aura servi à son insu à révéler un mensonge probablement plus énorme encore. A la fin des années quatre-vingt-dix, il fut en effet accueilli dans une famille texane en parvenant à se faire passer auprès de ses différents membres, dont la mère, pour le fils disparu quelques années plus tôt. Le lecteur est d’abord abasourdi par la possibilité même d’un tel subterfuge, puis découvre bientôt que ce retour impromptu aura probablement fourni un alibi inespéré à une famille loin d’être dupe et ayant vraisemblablement saisi ainsi l’occasion de masquer un crime familial (celle du fils, soi-disant disparu, par son demi-frère). On trouve presque là le scénario inversé de la Sirène du Mississipi (le roman de William Irish porté à l’écran par François Truffaut), un scénario où c’est cette fois l’abuseur qui se voit instrumentalisé pour couvrir un crime antérieur à son propre forfait…
Un crime parfait est plus intéressant encore. Il relève un cas singulier de présomption de crime "littéraire et post-moderne" (le roman se présentant comme la feuille de route du crime)…et interroge de manière forte le rapport de la fiction au réel : la critique littéraire devient policière et le débat narratologique prend une dimension judiciaire…
David Grann suivit de près les procès mais recueillit également de nombreux témoignages directs auprès des principaux intéressés (Bourdin, Bala, Wroblewski et leur entourage). Dans ces deux courts récits, il nous livre une prose précise, synthétique et sans faille. Il ne tranche pas (que peut-on penser de la rémission de Bourdin à partir de 2007 ? quel est son point de vue sur la culpabilité de Bala ?) et laisse le lecteur face aux interrogations à la fois factuelles et profondes que peuvent susciter en lui ces deux affaires uniques en leur genre.
Les lecteurs ayant trouvé ces deux textes concis dignes d’intérêt auront peut-être eu la curiosité de suivre David Grann vers un autre chemin, celui de l’enquête au long cours, où il s’avère encore plus brillant. La Cité perdue de Z, publié en 2009 aux Etats-Unis, est paru dans une traduction française de Marie-Hélène Sabard chez Robert Laffont en mars dernier. Concédons que la couverture de l’édition française (un choix dicté par la crise ?) fait plutôt songer à un remake papier de A la poursuite du diamant vert, et ne nous laisse pas immédiatement entrevoir qu’il pourrait s’agir d’un grand livre… La lecture n’en sera que plus saisissante.
Grann nous livre ici, dans une prose vivante et érudite, le fruit d’un travail de plus de dix ans consacré à Percy Harrison Fawcett, l’un des plus grands explorateurs victoriens de l’Amazonie. Fawcett, autodidacte issu d’un milieu modeste, devint l’un des enfants chéris de la Royal Geographical Society, la prestigieuse institution londonienne qui contribua activement au développement de la cartographie du monde et fut le levier financier de nombreuses missions exploratoires (notamment en Amérique du Sud et en Antarctique) à partir de 1830. Suite à de nombreuses explorations spectaculaires et relayées par la presse au cœur de l’Amazonie, Fawcett s’acharnera à vouloir révéler l’existence de la Cité de Z (ainsi baptisée par lui), vestige d’une civilisation fabuleuse enfouie dans un recoin inaccessible de la forêt amazonienne et dont il souhaitait coûte que coûte prouver l’existence. Il disparaîtra avec son fils en 1925 au cours d’une expédition que le manque de fonds dû aux nouvelles orientations scientifiques de la Royal Society et à la concurrence d’autres missions exploratoires plus au goût du jour, avait rendu quasiment suicidaire. Le destin singulier de Fawcett, sa disparition soudaine alors qu’il était jusqu’alors revenu sans la moindre écorchure des missions les plus dangereuses, incitera durant des années une pléthore d’aventuriers (des baroudeurs les plus illuminés aux explorateurs les plus organisés) à partir sur ses traces.
David Grann a consulté et compilé une somme impressionnante de documents et de témoignages sur P.H.Fawcett, sur ses contemporains, sur ses proches et sur cette période où les contours du monde n’étaient pas encore totalement tracés. Il consacre, enfin d’ouvrage, trente-cinq pages à ses sources : études sur Fawcett, écrits publiés ou carnets de bord inédits de l’explorateur, archives de la Royal Geographical Society et d’autres institutions, journaux intimes de membres de sa famille, témoignages directs, articles de revues spécialisées, mémoires et journaux d’autres explorateurs... Mais ses sources ne sont pas reléguées en annexe comme de simples preuves a posteriori de sa bonne foi. Il avance pas à pas avec elle, les cite abondamment au fil de son récit (avec notes en bas de page) et réussit, avec une virtuosité étonnante, à construire un récit à la fois extrêmement bien appareillé et pourtant passionnant de bout en bout.
La vie de P.H. Fawcett, ainsi étayée et resituée dans un contexte et une dynamique historiques, est en effet fascinante à plus d’un titre. David Grann nous introduit dans les coulisses d’une période étonnante de l’histoire moderne de l’exploration du monde. Si, comme il le rappelle au début de son livre «toute quête, dit-on, a une origine romantique», le désir de se plonger au cœur de la jungle amazonienne, ne revêt plus le même sens chez les explorateurs anglais de la fin du XIXème et du début du XXème siècle affiliés à la Royal Society que chez les conquistadors du temps des Grandes Découvertes :
« […] eux entreprenaient leurs expéditions au nom de Dieu, de l’or et de la gloire. La Société royale de géographie, elle, explore par amour de l’exploration et au nom d’un tout nouveau dieu : la Science »
Rêve en partie pieux, puisque le désir de gloire, tout au moins, reste une motivation forte. On verra que Fawcett est loin d’y rester insensible et qu’il connaîtra l’un des plus grands bonheurs de son existence lorsqu’il se verra attribuer la médaille d’or de la Royal Geographical Society, récompense convoitée entre toutes. Les enjeux de pouvoir et de reconnaissance entre les grands explorateurs ne sont pas non plus absents de cette histoire.
L’intérêt pour la science est par contre une donnée nouvelle en cette période où le positivisme est en plein essor et les explorateurs travaillent tous d’arrache-pied à alléger la carte du monde ces zones blanches désignées comme « inexplorées ». Le métier se professionnalise, on parle de « missions », la Royal Society développe des manuels et met en place un vrai dispositif de formation et de certification pour les futurs explorateurs… on y apprend entre autre à survivre aux morsures de serpents et aux flèches empoisonnées, à tromper la soif en faisant provision de salive, à remonter le moral des troupes en cas de morosité généralisée («encouragez de toutes vos forces, la gaieté, les chants et les violoneux»), à enterrer les morts avec les moyens du bord, à mesurer les indigènes à l’aide de dynamomètres, de crâniomètres, et de pieds à coulisse… Ces pages témoignent aussi de l’évolution à petits pas du regard ethnocentriste que l’Europe porte sur l’Autre. Evoquant un passage de Hints to Travellers, l’ouvrage de référence de la Royal Society, David Grann note que
«Le manuel met en garde contre "les préjugés inhérents au mode de pensée européen" tout en soulignant qu’ "il est établi que certaines races sont inférieures à d’autres sous le rapport du volume et de la complexité du cerveau, les Australiens et les Africains étant à cet égard inférieurs aux Européens" »
Si la première recommandation laisse entrevoir une certaine évolution par rapport aux périodes passées, Levi-Strauss et ses Tristes Tropiques sont toutefois encore loin…
Grann reprend également par le menu détail les grandes expéditions de Fawcett à partir des traces et témoignages qu’il a collectés. Là encore, la figure peu ordinaire de l’explorateur ne surgit pas comme un a priori allant de soi mais se dégage d’une somme de témoignages… Se dessine peu à peu le caractère hors du commun de P.H. Fawcett, sa détermination et son autoritarisme sans borne, sa résistance physique quasiment surhumaine (son épouse finira par le croire sérieusement à l’abri de la mort, ce qui lui rendra plus difficile encore l’acceptation de sa disparition définitive). Personne ne semble en mesure de le suivre dans la jungle et alors que ses collaborateurs les plus aguerris s’effondrent les uns après les autres sous les fièvres, le jeûne, la soif, les morsures d’insectes, les flèches des indiens et les infections de tout crin, Fawcett continue sans baisser de régime à avancer à coups de machette de quarante kilomètres par jour sous la canopée en restant parfois près d’un mois sans trouver la moindre nourriture. Fawcett fut également l’un des premiers à faire principe du respect socio-écologique du mode de vie des indiens et à refuser d’affronter les différentes tribus autochtones, même les plus hostiles, que les explorateurs croisaient sur leur chemin. Il fait le pari, au risque de sa vie et de celle de ses hommes, de manifester son pacifisme sous des déluges de flèches en ne ripostant pas. La formule fonctionne, les échanges de cadeaux succèdent aux massacres et il parvient ainsi à entrer en contact avec des populations qu’aucun explorateur n’avait pu approcher jusque là et à relier des zones restées inexplorées.
Peu de textes, hormis ceux des explorateurs eux-mêmes, nous fournissent des informations aussi réalistes et documentées sur les expéditions amazoniennes par voie de terre durant cette période ; et la consistance des sources de David Grann permettent presque de toucher du doigt le quotidien des hommes engagés dans ces missions (qui duraient parfois plusieurs années) tant sur le plan physique que psychologique.
Sous les pieds de Fawcett et de quelques autres la carte de l’Amérique du Sud s’étoffe, se complète et s’affine. Dès 1907 Fawcett a redessiné la topographie de la frontière bolivo-brésilienne. La Royal Society en retire les honneurs mais la réputation de l’explorateur anglais n’est déjà plus à faire.
Pourtant cet âge d’or ne durera pas éternellement. La première guerre mondiale, au-delà du fait qu’elle mobilise de nombreux explorateurs sur le front, redistribue les cartes. Au début des années vingt le monde a changé, la Royal Society subventionne moins, privilégie les recherches en Antarctique, scientifiquement plus porteuses, et les missions doivent de plus en plus faire appel aux fonds privés. De nouvelles figures font la une de la presse. Hiram Bingham, qui avait découvert le Macchu Picchu dès 1911 (cette «pin up de l’archéologie du XXème siècle» selon l'expression de l’explorateur Hugh Thomson) occupe encore le devant de la scène. Alexander Hamilton Rice, milliardaire et grand concurrent de Fawcett, déploie des débauches de moyens pour organiser des expéditions qui font de plus en plus d’ombre à ce dernier. Ils ne jouent pas dans la même cour. Alors que Fawcett se débat dans des problèmes financiers qui contraignent sa famille à des restrictions de plus en plus importantes, Rice lance un navire de quatorze mètres paré des derniers cris de la technologie sur le fleuve Amazone et met au point le premier récepteur radio capable de capter en temps réel depuis la jungle des informations venus d’Europe…
C’est pourtant au sortir de la Grande Guerre que Fawcett est décidé à réaliser le projet qui depuis des années lui tient à cœur : lancer l’expédition qui lui permettra de trouver la cité de Z, vestige d’une antique civilisation située quelque part dans ce vaste périmètre où Gonzalo Pizarro, inaugurant une longue série de désastres, conduisit plusieurs centaines d’hommes vers l’El Dorado et ses caciques d’or quatre siècles plus tôt. S’appuyant sur certains indices relevés lors de ses précédents voyages, sur des témoignages plus anciens de conquistadors et sur la rapide mise à jour de peintures rupestres par Rice lors d’une récente expédition qui tourna court, Fawcett est profondément persuadé de l’existence de ce site encore inexploré. Il n’en est plus aux rêves d’or des espagnols du XVIème siècle, mais il pense qu’au bout de sa route se tient une découverte qui pourrait changer la face du monde et le regard porté sur les civilisations amérindiennes d’Amazonie. Mais les crédits manquent, il peine à convaincre la Royal Society, des contre arguments forts lui barrent la route (on pense notamment que les conditions climatiques et biologiques en forêt amazonienne auraient rendu impossible l’essor d’une civilisation avancée). En 1921, il parvient enfin à se lancer une première fois, dans de très mauvaises conditions, vers la cité convoitée. Il finit par s’engager seul dans la jungle, manque y laisser sa peau au bout de quelques mois… Il pense toutefois, avant de renoncer, avoir aperçu les contours d’une cité. Il revient bredouille, mais bien décidé à repartir.
A ce stade, David Grann nous dépeint la dérive de P.H.Fawcett. L’explorateur s’enfonce financièrement (en 1923 il ne peut même plus s’acquitter de ses trois livres de cotisation annuelle auprès de la Royal Society), semble convaincre de moins en moins, se laisse aller à des élans quasi mystiques, se compromet avec le spiritisme en vogue qui lui apporte le soutien psychologique qu’il ne trouve plus ailleurs. Pendant ce temps l’écart se creuse avec Rice qui lance bientôt la plus grande expédition scientifique de tous les temps en Amazonie et, sur le fleuve, le premier hydravion… Fawcett refait toutefois surface et arrive à s’arracher à cette spirale pour entreprendre ce qui sera sa dernière expédition. Il part avec son fils Jack et un autre équipier nommé Raleigh. Accompagnés un temps par des guides brésiliens, les trois hommes s’engagent ensuite seuls dans la jungle, prêts à traverser les territoires indiens les plus hostiles dans l’espoir d’atteindre enfin la cité promise. Les trois hommes n’en reviendront jamais.
La disparition de Fawcett nourrira un temps des légendes. On lui prêtera différents destins extravagants allant de l’ermite au chef de tribu. Quelques opérations de secours seront organisées pour le retrouver, dont celle de George Miller Doyott en 1928. Des acteurs d’Hollywood, des missionnaires, des aventuriers des quatre coins du monde perdront la vie en se lançant sur ses pas (on estimait en 1930 à plus d’une centaine le nombre de victimes des « expéditions Fawcett »). Dans les années quarante, Villa Boas, un indigéniste brésilien pensera même avoir retrouvé ses ossements, ce qui sera infirmé par la suite. Des recoupements plus fiables laisseraient penser que les derniers à avoir rencontré les trois hommes furent des indiens Kalapalos et que les explorateurs auraient été tués après leur départ vers un autre territoire au cours d’une altercation avec des indiens Suyas.
Mais ce récit est aussi celui de la propre investigation de David Grann. Car après avoir lu à peu près tout ce qui pouvait l’être, réuni des témoignages, accédé à des documents quasiment introuvables ou inaccessibles, David Grann, fidèle à une décision prise depuis longtemps, à un envoûtement auquel il avait accepté dès le début de céder, partira à son tour sur les traces de Fawcett.
Il n’y a pourtant aucune marque d’héroïsme dans le récit de cette quête et de cette expédition tardive (la dernière n’occupant finalement qu’une partie congrue du livre). Bien au contraire, le journaliste américain se présente plus volontiers sous les traits d’un proche cousin de Woody Allen que sous ceux d’un descendant spirituel de son explorateur préféré :
« Que les choses soient claires : je ne suis ni explorateur ni aventurier. Je ne pratique ni l’alpinisme ni la chasse. Je n’aime même pas le camping. Je mesure moins d’un mètre soixante-quinze et j’ai bientôt quarante ans, des poignées d’amour et des cheveux noirs de moins en moins fournis. Je souffre d’un kératocône : une maladie dégénérative de l’œil qui rend improbable ma vision de nuit. J’ai un sens de l’orientation consternant et, dans le métro, j’ai tendance à louper ma station de Brooklyn. J’aime les journaux, les plats préparés, les grands événements sportifs (enregistrés sur disque dur) et la clim poussée au maximum. Pour gagner mon appartement, j’ai le choix entre monter deux étages à pied ou prendre l’ascenseur : j’opte quotidiennement pour l’ascenseur »
La cité perdue de Z alterne entre des chapitres consacrés à Fawcett (les plus importants) et le récit des recherches et des préparatifs du journaliste. L’aventure commence d'ailleurs bien avant le déplacement de Grann en Amazonie. Si l’on pense parfois à Konrad en lisant le livre de Grann, le cœur des ténèbres se situe ici plus souvent dans l’obscurité des bibliothèques et des salles d’archives que dans la jungle. Il lui faut lire, chercher, pénétrer le cercle familial de Fawcett, accéder à des textes privés, les décrypter, faire le tri entre ce que l’explorateur a voulu dire, ce qu’il a parfois souhaité cacher à la Royal Society par crainte de se faire doubler par d’autres explorateurs. Il lui faut comprendre. Le voyage tant attendu aura pourtant bien lieu. Toujours humble, David Grann souligne avant tout ce que son incursion dans le Xingu de Fawcett aura de léger au regard des expéditions de l’explorateur anglais. La forêt, au prix de nombreux sacrifices écologiques, a été aménagée, des voies ont été tracées. Il lui faut quelques jours pour relier des points que Fawcett aurait mis plusieurs mois à atteindre. Le voyage, point culminant de cette longue investigation, sera toutefois payé de retour. David Grann entendra de la bouche d’indiens Kalapalos, à partir de récits colportés par la tradition orale, l’hypothèse la plus probable concernant la fin de Fawcett. Et surtout, il finira par rencontrer Michael Heckenberger l’archéologue spécialiste du Xingu, qui lui confirmera, en lui détaillant de récentes découvertes de routes attestant l’existence de nombreux sites urbanisés datant de plusieurs siècles avant l’ère chrétienne, que Fawcett ne s’était pas trompé…
Le texte de David Grann est finalement le récit d’une double aventure. Celle de la quête de Fawcett et celle du journaliste qui le suit à la trace. Une enquête dévorante et chronophage dans laquelle Grann s’est engagé sans retour possible mais sans vraiment comprendre pourquoi. Sur ce qui peut tenir lieu de motivation à une quête de ce type, David Grann dit «je serais bien en peine, aujourd’hui encore, d’en trouver une à la mienne». A peine avancera-t-il un certain goût immodéré pour «les histoires qui vous mettent le grappin dessus»… Pourtant, quelque chose nous dit que David Grann, au-delà de sa modestie naturelle, a sans doute un peu trouvé chez Percy Harrison Fawcett et son obsession de la quête un double de lui-même.
1) Parmi les nombreuses parutions figurant dans la collection à trois euros des éditions Allia, on se permet d'en souligner deux autres pour l'année 2009 : Près de la voie ferrée, de Zofia Nalkowska (présentation ici sur la Marche aux Pages) et la Vie de personne, texte remarquable de l'écrivain italien oublié Giovanni Papini, dont on peut lire une très bonne chronique sur le site du Vampire Réactif.
2) Le roman Amok, paru en Pologne et vendu à environ deux mille exemplaires, n'a apparemment jamais été traduit, ni en anglais, ni en français
David Grann,
Le Caméléon. Editions Allia. 2009 (traduit de l'américain par Claire Debru)
Un crime parfait. Editions Allia. 2009 (traduction de Violaine Huisman)
La Cité perdue de Z. Robert Laffont. 2010 (traduction de Marie-Hélène Sabard)
Images : 1) Photo d'Emmanuel Benito / 5) Carte des différentes expéditions de P.H.Fawcett en Amérique du Sud (lastdaysoftheincas.com) / 6) David Grann



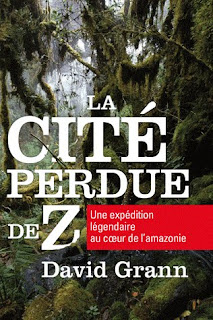


Le souffle romanesque allié à une solide enquête me rappellent, concernant une époque antérieure et d'autres latitudes, "les Passagers anglais" de Matthew Kneale, qui m'avaient enthousiasmé et beaucoup fait rire.
RépondreSupprimerhttp://rh19.revues.org/index396.html
http://www.belfond.fr/site/les_passagers_anglais_&100&9782714438683.html
Merci pour ces découvertes : je partirai bientôt grâce à vous en Amazonie.