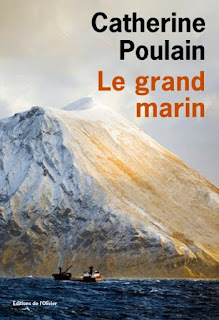Figure
monumentale de la musique rock des années 60, et première femme blanche à avoir
inscrit sa voix en lettres d’or dans l’histoire du blues, Janis Joplin continue
de se rappeler inlassablement à nous. Sa
vie fulgurante, ses addictions, sa disparition prématurée à l’âge de 27 ans (qui
lui valent une place de choix dans le fameux Forever 27 club), ont
contribué au moins autant que son timbre si particulier et sa présence « électrique »
à forger le mythe qu’elle incarne.
Philosophe, romancière, poète et essayiste, Véronique Bergen est aussi familière de cette époque et avait déjà consacré un livre à Edie Sedgwick, Edie. La danse d’Icare (nous avions par ailleurs parlé ici de l’admirable biographie que Jean Stein avait consacrée à l’éphémère égérie de Warhol). Elle nous revient aujourd’hui avec un roman choral autour de la chanteuse texane : une sorte de « biografiction » qui multiplie les angles et les voix et nous immerge, par une manière de voyage intérieur avec Joplin, dans le cœur battant du rêve sixties et de sa fin pressentie.
Joplin a
poussé sur un terreau amer, celui « d’une
ville pétrolière du Texas, une ville défigurée par les forages, par les
gisements d’or noir ». Elle vient d’un Sud socialement dévasté pour
beaucoup et va très vite trouver dans les vibrations du blues de quoi « effacer Port Arthur de la carte du monde ».
Sa voix s’est trouvée dans une ligne qui va toujours du plus lisse au moins
lisse, de la blessure entrevue à l’écorchure assumée, une plante enragée qui a
poussé à l’envers. L’évolution de son timbre a parfois été attribuée aux excès
qui ont marqué sa vie. Il faut plutôt y voir, nous dit Bergen, la quête d’un
chant débarrassé de toute forme de d’afféterie, de diversion : un chant
sans joliesse pour porter une déchirure à l’état pur : « Les puristes qui séparent sa voix d’avant
la dérive éthylique de celle d’après, regrettant la perte de la première, n’ont
rien compris. »
C’est
dans cet élan vers le bas, le fond, le dedans, que nous entraîne le texte de
Véronique Bergen. Bien qu’extrêmement documenté, son « récit » s’apparente
lui-même plus à une proposition musicale qu’à un essai biographique. Un
portrait chanté, pourrait-on dire, tant son écriture joue des
ressorts de la rage, de la polyphonie et s’autorise des variations de gamme qui
font de ce livre un texte fort et singulier. Pour faire « parler »
Joplin, elle recourt aussi bien, selon l’inspiration du moment, à la première personne
du singulier qu’à la seconde ou à la
troisième. Elle place d’autres voix en « interludes », celles de Hendrix,
Morrison, mais aussi celles du Peer Gynt
de Grieg ou du Porgy and Bess de
Gerschwin, de l’héro ou de la guitare électrique… Le récit tisse finalement une
sorte d’opéra rock qui digère les informations, les sources (et elles ne
manquent pas) pour les recracher sous forme de notes.
L’auteure
semble aussi chercher à restituer ce qui fut le souffle d’un rêve et d’une
révolte aujourd’hui essorés. On repasse par les concerts légendaires de
Monterrey, Woodstock, les surgissements qui firent date (les premiers solos de
Hendrix sur fond de guerre du Vietnam), on se glisse dans la chair des chansons
qui ont poussé Joplin vers des instants de musique absolue. On la suit aussi
dans ce qui annonce la fin de ce monde-là, de cette faim-là. Le Flower Power
retombera bientôt en cendres dans la main du capital, les Hippies deviendront
des Yuppies, les « enfants du rock » rentreront dans le rang et c’est
peut-être, suggère l’auteure, à ce morne raccrochage que s’est
refusée d’assister Joplin en s’injectant sa dernière et fatale dose de voyage.
Pas de
leçon, ni de morale à tout cela. Janis Joplin a occupé la place
impossible, introuvable qui fut la sienne. Déchirée, toujours en manque (de
chant, de drogue, de sexe ou d’alcool), elle nous aura laissé cette voix,
incomparable et inconsolable, que nous fait aujourd'hui encore réentendre le beau livre de
Véronique Bergen.
Véronique Bergen, Janis Joplin, voix noire sur fond blanc. Al Dante. 2016.