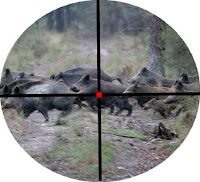.
Avec l’Eté de la vie, J.-M. Coetzee signe le troisième volet d’une suite autobiographique entamée en 1997 avec Scènes de la vie d’un jeune garçon. L’arrêt sur image se fait cette fois sur les années 70, période où, écrivain encore peu connu, Coetzee revient en Afrique du Sud après quelques années passées aux Etats-Unis et s’installe dans la région du Cap avec son père. Derrière ce titre, qui à la lecture du livre résonne vite comme une antiphrase, se déploie le portrait en mosaïque d’un trentenaire taciturne et solitaire. Un homme qui semble se fondre dans la grisaille d’une existence désenchantée avec pour toile de fond l’ombre discrète d’une nation déchirée par sa propre violence. Mais c’est par la construction d'une fiction que l’écrivain sud-africain choisit de nous restituer un peu de cette part de lui-même… Le Coetzee que nous connaissons vient de mourir et un universitaire anglais s’est mis en tête de rédiger sa biographie. Il mène pour cela une série d’entretiens auprès des quelques personnes encore vivantes qui ont connu l'écrivain une trentaine d’années plus tôt. Ce détour aurait pu prêter le flanc à un bel et habile exercice d’immodestie. Il sert au contraire un récit d’où l’humour et l’autodérision ne sont pas absents mais où s’expriment avant tout l'effacement d'un homme devant la fragilité de l’existence, et cette sorte d’amertume retenue qui est au cœur de l’œuvre de Coetzee.
Le biographe imaginaire de feu J.M. Coetzee n’a pas eu la tâche facile. La vie sociale et intime de l’écrivain, qui s’improvise ici en personnage posthume, ne semble pas avoir laissé foison de traces ni d’impressions inoubliables, surtout sur la période considérée. Il nous livre un travail en cours, centré autour de cinq personnes l’ayant connu dans les années 70, à l’époque de son retour au pays natal. Il y aura tour à tour Julia, la maîtresse exubérante, Margot la cousine afrikaaner, Adriana la veuve brésilienne vainement courtisée durant un temps par celui qui fut le professeur d’anglais de sa fille, Martin qui ne côtoya Coetzee que lors d’un entretien de recrutement pour un poste d’enseignant à l’université du Cap et Sophie, une collègue française restée en Afrique du Sud après son divorce et avec qui il eut une liaison peu durable. Voilà la matière relativement limitée que le jeune investigateur va tenter d’exploiter de son mieux, relançant les questions, réclamant des précisions afin d’avancer, parfois tant bien que mal, dans le sujet qui l’occupe. A ces cinq témoignages s’ajoutent, en début et en fin de texte, quelques extraits de carnets annotés de l’écrivain.
Ce faux brouillon biographique tisse peu à peu récit singulier, impose un rythme, une densité. Le morcellement des points de vue, généralement utilisé pour démultiplier les perceptions possibles d’une même réalité, produit ici un effet inverse, ou à tout le moins plus subtil. Les différents témoins dévoilent en effet une figure à peu près partagée, et jamais flamboyante, de l’homme que fut Coetzee : celle d’un individu inhibé, peu sociable, sans ambition et qui semble épouser une apathie substantielle jusque dans ses désirs les plus vrais. Ces grands traits constituent un thème autour duquel les variations se joueront plutôt sur le versant des témoins. Entre émotion, humour, dénégation, les témoignages se suivent et ne se ressemblent pas, s’accordant seulement en ce qu’ils renvoient de l’homme dont il est question une image à peu près similaire…
Certains de ces témoins auront même tendance à détourner l’exercice pour parler avant tout d’eux-mêmes. Leur prise de parole prend parfois des allures comiques comme chez Julia, qui apparaît peu à peu comme un personnage semi-hystérique : elle ouvre régulièrement des parenthèses, ramène de plus en plus souvent le propos à elle, annonce sans cesse qu’elle n’ajoutera qu’une «dernière chose» avant de rebondir sur un nouvel épisode ou une nouvelle digression, toujours plus long que le précédent. Ce qu’elle redoute plus que tout, est de figurer comme un personnage secondaire dans la vie de l’écrivain, défendant avant tout le principe selon lequel c’est lui qui fut au second plan dans sa propre vie amoureuse. Elle met en garde le biographe contre un tel travestissement :
«Vous faites une lourde erreur si vous vous dites que la différence entre les deux histoires, l’histoire que vous vouliez entendre et l’histoire que je vous livre, n’est rien d’autre qu’une question de perspective – que si, de mon point de vue, l’histoire de John n’aura peut-être été qu’un épisode parmi d’autres dans la longue histoire de mon mariage, néanmoins par un petit tour de passe-passe, une rapide manipulation de la perspective, un travail d’édition astucieux, vous pouvez transformer cela pour en faire une histoire sur John et l’une des femmes qui sont passées dans sa vie. Ce n’est pas le cas. Pas du tout. Je vous avertis très sérieusement : si vous partez d’ici et commencez à tripatouiller le texte, tout ne sera plus que cendres entre vos doigts.»
Car dans ce work in progress biographique, bien des questions se posent : où se trouve, s’il en existe une, la vérité d'un homme ? Evoquant Coetzee, certains de ces témoins ne jouent-ils pas eux-mêmes à cache-cache avec leurs propres peurs, leurs propres sentiments ? Qu’accepte-t-on ou pas de révéler, de dire ou d’avoir dit ? Si certains entretiens sont présentés comme des dialogues restitués, d’autres sont amenés comme les relectures d’entretiens déjà effectués et que le biographe soumet à la validation de ses interlocuteurs. C’est notamment le cas avec Margot, la cousine sud-africaine retrouvée dans les années 70. Lors de cette relecture, elle demande à plusieurs reprises que tel passage, que nous sommes en trains de lire, soit supprimé ou reformulé…
« - C’est pourtant ce que vous avez dit.
- Oui, mais vous ne pouvez pas transcrire ce que j’ai dit mot pour mot et le faire savoir au monde entier. Je n’ai jamais donné mon accord là-dessus. »
Coetzee joue ici constamment avec le travail de censure et d’autocensure qui est au cœur de l’écriture (auto)biographique.
Dans ce jeu de perspectives, l’auteur se complaît aussi à une certaine forme d’autodérision. De nombreuses scènes qui émaillent les souvenirs des différents personnages évoquent des ratés : pannes de voiture, barbecues moroses, répliques inappropriées. Le jeune homme renvoie constamment de lui-même, à travers ces témoignages, une image terne et maladroite.
Si certains de ses rendus portent à sourire, on n’est toutefois loin de la performance humoristique systématique. La maladresse est sans excès et le manque de chaleur et d’engagement traduit sans doute quelque chose de plus grave, de plus profond et que ne rachète aucun effet spectaculaire. Un mal-être venu de loin et suffisamment digéré pour avoir perdu toute grandiloquence. Une forme de malaise existentiel diffus autour duquel le lecteur gravite en permanence sans jamais pouvoir y entrer de plan pied. Tant et s’y bien que le portrait de l’écrivain semble s’effacer au fur et à mesure qu’il se construit.
Quelques éléments transparaissent parfois auxquels il est possible de rattacher cette mélancolie. Il y a notamment cet étrange pays au cœur duquel la communauté Boer a pris racine et poussé comme une aberration historique. Un pays que Coetzee, dans les premières pages de l’Eté de la vie, dit porter en lui comme une souillure que même l’exil ne parvient pas à laver. Une forteresse où la violence s’est développée comme une seconde peau. Il n’y a le plus souvent aucune analyse politique ou historique dans le texte mais des brèches qui laissent filtrer cette violence, la rendent soudain palpable. Ce sont ces crimes et ces règlements de compte que l’homme de retour chez lui retrouve dans les entrefilets des journaux alors que son père vieillissant semble s’être résigné à une forme d’indifférence amère ; ces trains qu’il est impossible de prendre passée une certaine heure ; le mari d’Adriana, agressé à coup de hache au cours de l’attaque du hangar qu’il surveillait sur les docks et dont elle a accompagné la lente agonie ; ces détails du quotidien qui rappellent au détour d’une phrase les frontières infranchissables qui séparent l’univers des Blancs de celui des Noirs.
Ce pays condamne ainsi ceux qui en sont à un attachement douloureux parce que vécu comme absurde, à une nostalgie déraisonnable. C’est peut-être dans le récit de Margot, la cousine de sang, que l’on trouve les pages les plus poignantes. C’est sans doute entre eux que se dessine la relation la plus forte, une relation de tendresse amoureuse enfouie auquel cet «homme de bois» n’a jamais su donner la moindre forme, ni par les gestes ni par les mots. Au retour d’un déplacement à Merweville, une petite ville désolée où Coetzee envisage un temps de s’installer avec son père, ils se retrouvent immobilisés par une panne de moteur dans le Karoo, cette vaste plaine désertique qui semble refléter l’âme aride du pays. Dans ce «non-lieu» éloigné de tout, les deux cousins semblent un instant partager la même vision du pays et de ce qui les y retient.
«Ce coin du monde. Elle ne pense pas à Merweville ou Calvinia, mais à tout le Karoo, au pays tout entier peut-être. Qui a eu l’idée de faire des routes, de poser des voies de chemin de fer, de bâtir des villes, d’y faire venir des gens et de les attacher à ce pays, de les y river par des liens qui leur percent le cœur, de sorte qu’ils ne peuvent s’échapper ?»
Mais derrière ce sombre attachement, le pays devient parfois la métaphore d’un mal plus vaste qui dit la fragilité même de notre présence au monde. Dans le Karoo, Coetzee repense au passage d’un livre d’Eugène Marais consacré à l'observation d'un groupe de babouins.
«Il écrit qu’à la tombée de la nuit, quand la bande cessait de chercher à manger et regardait le soleil descendre, il voyait percer dans les yeux des plus vieux babouins comme une pointe de mélancolie, comme si naissait en eux la conscience de leur mortalité.»
Une conscience qu’aiguisent en lui les paysages désertiques de son pays.
«[…] Je comprends ce que le vieux babouin pensait en regardant le soleil descendre, le chef de la bande, celui dont Marais se sentait le plus proche. Jamais plus, pensait-il : Une seule vie et puis jamais plus. Jamais, jamais, jamais. C’est l’effet que le Karoo a sur moi. Le pays me rend tout mélancolique. Il me gâche le goût de vivre.»
L’écriture, vers laquelle s’est déjà définitivement tourné Coetzee à cette époque de sa vie, ne sera pas tant l’occasion d’échapper à cette prison de l’âme que de la ressasser de diverses manières. L’évocation de ce travail d’écrivain occupe une part mineure dans l’Eté de la vie. Cela relève d’un choix du biographe imaginaire et cet engouement est avant tout perçu par les yeux de ceux avec lesquels celui-ci s’entretient. Coetzee n’a alors écrit que quelques livres, dont Terres de crépuscule, dans lequel Julia décrypte quelque chose qui ressemble un peu à l’image que cet homme lui renvoie :
«Je ne dis pas que l’écriture des Terres de crépuscule manque de passion, mais la passion qui informe l’écriture reste obscure.»
Tout comme le cœur de l’écrivain semble hermétique à ceux qui l’ont connu, son goût pour l’écriture est avant tout appréhendé par eux comme un prolongement de sa solitude, une façon de creuser ce décalage qui le fait passer à côté des autres et de la vie. Margot, d’abord irritée par la panne qui les bloque dans le Karoo et que son cousin n’arrive pas à résoudre, s’emporte silencieusement contre lui et les siens.
«Une famille loufoque, sans plomb dans la tête ; des clowns. ‘n Hand vol vere* : une poignée de plumes. Et même celui d’entre eux en qui elle avait mis quelque espoir, qui est assis à côté d’elle et qui est reparti tout de suite au pays des songes, s’avère être un poids plume. Il s’est sauvé à la conquête du vaste monde et revient maintenant tout penaud dans leur petit monde, la queue entre les jambes. Un évadé raté, un mécano raté en plus, et c’est elle qui en ce moment fait les frais des bourdes de cet incapable. Et un raté de fils. Il va glander dans cette vieille maison poussiéreuse de Merweville, mordillant un crayon en essayant de vous tourner des vers. O droë land, o barre kranse… Ô terre sèche et aride, ô falaises ingrates… Et ensuite ? Quelque chose sur la weemoed, la mélancolie, pour sûr.»
Cette mélancolie, sans doute, a fait son chemin. Et loin des envolées lyriques évoquées dans ce passage, la weemoed de Coetzee s’est faite minérale. Dans l’Eté de la vie, elle alimente encore à mots mesurés l’une des écritures les plus exigentes de notre temps. Ce récit polyphonique, où les effets de distance se mêlent à un désespoir radical, approche par cercles concentriques un centre de gravité qui se dérobe sous nos yeux. Et l’exercice autobiographique, fût-il détourné, semble d’une certaine manière voué à l’échec. Il nous laisse sur le seuil d’un cœur fermé à double tour qui ne se dévoile jamais tant qu’entre les lignes.
*Margot et John communiquent en afrikaans. Certains passages de leurs dialogues figurent dans cette langue, suivis de leur traduction en incise directe dans le texte.
John Maxwell Coetzee, l'Eté de la vie. Editions du Seuil. 2011. Traduit de l'anglais par Catherine Lauga Du Plessis.
Images : 1) Photographie d'Eugen Richards (source) / 3) Photographie de Michaël Subotzky (source) / 4) Le Karoo (source)